Après Wesh Wesh (2002) et Bled Number One (2005), l’Algérien Rabah AmeurZaïmèche revient sur la Croisette avec un nouveau long-métrage Dernier Maquis qui a été présenté dans le cadre de la sélection «La Quinzaine des réalisateurs». Dans ce film, Rabah Ameur-Zaïmèche autopsie la banlieue : il en brosse un tableau de l’islam en France, analyse les rapports de force entre clans et souligne la misère et l’ignorance qui sont le fruit de l’abandon de la banlieue.
La salle était comble. Le film a été très attendu. Dans la salle, plusieurs professeurs de lycée se stressaient à contrôler leurs élèves qui ont fait le déplacement pour voir le film qui s’ouvre sur une couleur rouge dominante, celle des palettes de bois que plusieurs ouvriers s’affairent, comme des Sisyphes, à déplacer dans tous les sens. Très vite la caméra rentre dans ce labyrinthe : elle fait une incursion dans cette zone industrielle à l’agonie où Mao, un patron musulman, fait travailler des ouvriers qui réparent des palettes en bois.
Ameur-Zaïmèche profite de ce glissement de caméra pour sonder les relations entre les personnes du groupe au sein duquel on trouve un mécanicien d’origine portugaise qui a décidé de se convertir à l’islam. Tout allait bien jusqu’au moment où Mao finance et ouvre une mosquée à la tête de laquelle il met un imam protégeant ses affaires. Les choses se corsent. Après avoir assisté à quelques prêches, Mao et les mécaniciens (parmi lesquels Abel Jafri) s’élèvent contre l’imam imposé par le patron et préfèrent prier ensemble sur leur lieu de travail.
Le scénario met également en valeur Titi (Christian Milia-Darmezin), un jeune mécanicien qui se convertit à l’islam et travaille dans ce garage de poids lourds appartenant à la même entreprise. Ce cas justement pointe du doigt la bêtise de certains banlieusards qui se convertissent à l’islam sous l’effet de discours obscurantistes.
la monotonie, qui singularisent les scènes, cette fiction filmée comme un documentaire révèle les manipulations et les luttes entre les personnes et les clans. Il démontre comment des rapports de force s’installent au sein du groupe pour montrer des dominants et des dominés avec ce côté imprévisible chez l’être humain le poussant à la révolte et à vouloir changer l’ordre établi.
Avec cette composante du groupe, des jeunes Portugais, Africains, Algériens etc. issus de la banlieue, le cinéaste a mélangé humour, sérieux et réflexion. Avec cette œuvre AmeurZaïmèche clôt aussi sa trilogie sur la banlieue dont Bled Number One l’a emmené à voyager en Algérie, et espère certainement la clôturer avec une distinction cannoise. Il a toutes ses chances !
T.H

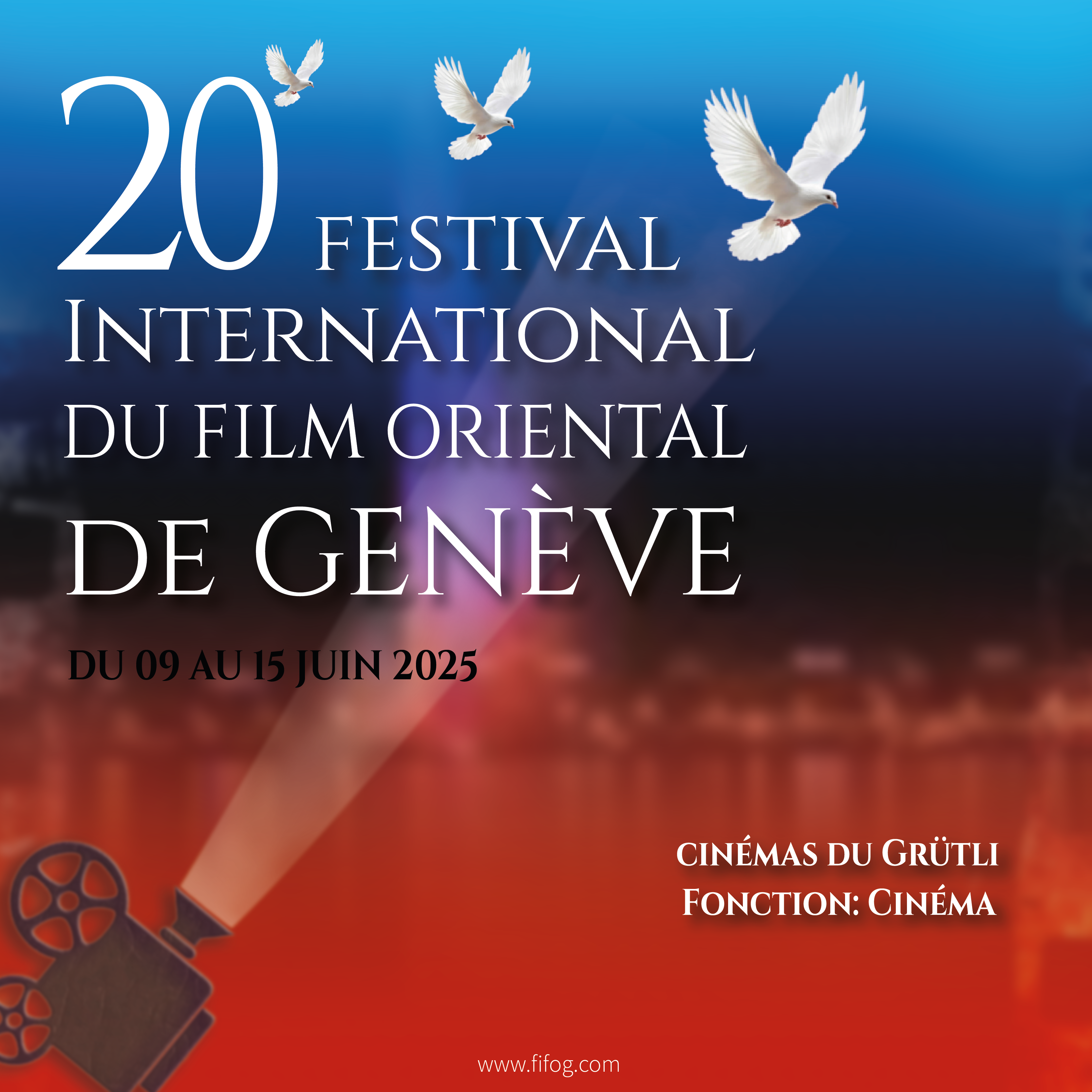






Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.